
LA TRIBUNE - Nous venons de vivre une année inédite sur le front de la lutte environnementale. Alors que vous avez récemment observé une montée en puissance de ces contentieux, quels sont les dossiers qui ont marqué l'activité de la cour ?
LUC DEREPAS - Les dossiers qui portent sur l'eau et les retenues sont en phase ascendante. Les tribunaux administratifs ont statué sur les constructions des premières réserves et on sait qu'il y a encore pas mal de projets sur les étagères de l'administration. C'est un contentieux qui vraisemblablement ne va pas se tarir si j'ose le dire ainsi, puisque la raréfaction de la ressource est en train de se généraliser. Face à cette situation, les acteurs économiques et les acteurs sociaux ont des stratégies qu'ils sont en train d'affiner. Une bonne partie de la ressource en eau consommée va à l'agriculture, et le secteur agricole essaye de préserver sa ressource, d'où la construction des mégabassines. Ce qui conduit à thésauriser de l'eau qu'ils extraient des nappes aquatiques. Évidemment, cela bouleverse les équilibres sociaux et suscite des réactions très fortes.
Dans les dossiers en attente, nous avons beaucoup d'affaires relatives à des installations éoliennes ou photovoltaïques, ça a été le gros des contentieux environnementaux qui sont arrivés ces cinq dernières années. On est en train de les traiter, ils sont extrêmement lourds, avec parfois plusieurs milliers de pages. Pour les magistrats et la juridiction, c'est une charge très lourde. La spécificité pour la cour de Bordeaux, c'est que nous traitons 30 % des contentieux liés à l'éolien à l'échelle nationale, soit 60 affaires par an. Ce qui nous donne à la fois une très bonne compétence mais aussi une charge particulière. Le nombre de dossiers entrants ne diminue pas, tant qu'il y a encore de la place pour construire des éoliennes, on continuera à avoir des contentieux de ce type.
En décalage avec l'actualité Après le Tribunal administratif, la Cour administrative d'appel est la deuxième juridiction d'instance qui traite les projets dépendant d'une autorité administrative (parc solaire, éolien, logements, infrastructures de transports...). Pour ces deux tribunaux, la durée de traitement d'un dossier va de un à deux ans. Ainsi, les audiences de la Cour administrative d'appel interviennent en moyenne entre 2 et 4 ans après le dépôt initial du recours. Exception faite des dossiers liés à l'éolien qui passent devant cette cour en première instance afin d'accélérer leur traitement. A Bordeaux, avec ses 31 magistrats et 35 greffiers, elle rend entre 3.500 et 4.000 décisions par an à travers 120 audiences.
Le contentieux autour des bassines dans les Deux-Sèvres relève d'un territoire à l'hydromorphologie particulière. Les jugements rendus par votre Cour n'ont donc pas vocation à faire jurisprudence ?
Non, chaque affaire est spécifique, surtout sur la ressource en eau. La loi exige des préfets qu'ils autorisent les retenues d'eau en se basant sur les ponctions effectuées durant la décennie précédente, avec un mécanisme de dégressivité qui fait que le préfet doit autoriser à chaque fois un volume de prélèvement moindre. Il s'agit donc d'examiner la situation sur le bassin versant demandé et prendre sa décision en fonction de cette situation. C'est donc propre à chaque territoire.
A l'image de Nature environnement 17 qui a fait valoir devant votre Cour l'illégalité de bassines construites en Charente-Maritime, les défenseurs de l'environnement sont désormais capables de monter des dossiers très solides...
Oui, ils sont très bien armés. En matière environnementale, c'est tout de même une tradition d'avoir un niveau de compétence élevé. On a des mémoires, très fouillés, précis, charpentés en droit, ce qui rend d'autant plus malaisé pour l'administration de défendre des dossiers où il peut y avoir parfois certaines faiblesses.

Le 25 mars 2023, la bassine de Sainte-Soline, en construction dans les Deux-Sèvres, a été le théâtre de très violents affrontements. (crédits : MG / La Tribune)
Cela légitime encore plus votre rôle, alors que nous avons vu cette année des activistes contester des décisions de justice en s'attaquant à des installations. Comment appréhendez-vous cette remise en question du droit ?
Là on touche aux limites de notre activité et à la question du rôle de la loi dans la régulation sociale. Nous, nous appliquons la loi, nous disons si le droit permet ou non d'autoriser une installation, ou avec des conditions. Les acteurs sociaux peuvent être en désaccord avec nos décisions et en désaccord avec la loi. Il y a une chose sur laquelle je me dis que le législateur n'a pas encore suffisamment bien organisé les choses, c'est sur la concertation en amont. Sur de nombreux contentieux, les gens ne défendent pas des droits et un point de vue juridique mais ils utilisent le droit à des fins de contestation sociale d'un certain nombre d'installations. Ce ne sont pas des litiges d'ordre juridique - sociaux ou économiques. Si on en arrive là, c'est qu'il n'y a pas eu le travail politique de concertation et de conciliation pour rapprocher les points de vue.
Vous avez vous-même été engagé en politique, en tant que secrétaire général de la campagne de l'écologiste Yannick Jadot. Êtes-vous sincèrement impartial dans votre rôle de magistrat ?
Si j'ose dire, c'est dans les gènes des juges administratifs de l'être. On a souvent des activités extérieures, parfois proches du politique. Il est clair pour nous que dès que l'on retrouve notre habit de juge, on est dans une autre fonction et on retrouve notre raisonnement de juge. Il y a une éthique de l'impartialité qui est très forte dans la justice administrative et à laquelle on s'astreint tous.
Durant l'année écoulée, je me suis tenu à ne pas prendre part ou présider des audiences dans lesquelles je pourrais apparaître comme étant partial. J'ai tenu à ne pas statuer sur des litiges mettant en cause des points politiques relatifs à la mairie de Bordeaux par exemple [dont le maire Pierre Hurmic est écologiste, NDLR].

Luc Derepas est un haut-fonctionnaire formé à l'ENA. (crédits : Agence APPA)
Les contentieux liés à l'environnement peuvent-ils amener un renforcement du droit de l'environnement ?
Aujourd'hui, on a quand même un appareil juridique extrêmement précis et large dans tous les intérêts qu'il appréhende. Je vois mal comment on pourrait aller plus loin. Je prends l'exemple de l'éolien : vous avez des installations qui sont assez visibles dans le paysage, auxquelles on reproche de générer certaines nuisances. Au regard de quelles règles examinons-nous la légalité des décisions rendues par le préfet ? On voit que le corpus juridique s'est très fortement enrichi : les premières séries de règles sont techniques, puis il y a la question de l'insertion dans l'environnement avec l'atteinte au paysage qui est déjà plus impressionniste, impalpable, et enfin les normes sur la préservation des espèces protégées en vertu du droit européen. C'est pour cela qu'au bout du compte, les contentieux éoliens ne se jouent plus tellement sur les aspects techniques, car les opérateurs connaissent toutes les règles, mais plutôt sur l'insertion dans le paysage et beaucoup sur la question des espèces protégées.
Néanmoins, quels sont les sujets sur lesquels la loi n'anticipe pas assez les changements à venir ?
Il y a des intérêts en présence qui vont générer la création de nouvelles normes juridiques dans le domaine de l'eau parce que je pense que le corpus actuel, avec ce mécanisme de dégressivité, ne répond pas à la demande sociale. Il faudra arriver à des mécanismes beaucoup plus précis et contraignants de répartition de la ressource en eau. Cela va plus loin qu'une gestion simplement « raisonnée ». On va voir émerger des situations très délicates, quand il faudra dire que l'on privilégie plutôt l'agriculture à l'industrie ou l'eau potable dans une région, et que dans une autre région ce sera l'inverse... C'est pour cela qu'il faudra des mécanismes de concertation bien plus puissants en amont pour que la société accepte les changements.
Les corpus juridiques vont aussi se durcir, à mon avis, sur la question du retrait du trait de côte. Le législateur a commencé à appréhender qu'il y a un mécanisme irréversible, notamment dans notre région. Le juge administratif va devoir rendre des décisions très difficiles en terme de retrait des populations et des installations économiques des endroits où elles se trouvent actuellement, avec des expropriations et des interdictions de construction. C'est tout l'équilibre de la loi Littoral [promulguée en 1986, NDLR] qui est remis en cause. Pour l'instant, elle dit que l'on peut construire en continuité sur la côte et dans le périmètre d'une zone littorale déjà urbanisée. Si on maintient ces règles-là, la situation va exploser. Il faut imaginer d'autres mécanismes de régulation dans ces zones-là pour éviter des cas comme Le Signal [à Soulac-sur-mer en Gironde, ndlr]. Dans les dix ans qui viennent, on va avoir affaire à des situations vraiment dramatiques.
Et il sera trop tard pour gagner l'acceptation sociétale ?
Si on ne prend pas de décision maintenant, on va se retrouver avec des mécanismes qui obligeront les gens à quitter leur habitation pour des raisons de sécurité. Ce seront des décisions très dures et qui ne seront parfois pas comprises. Pour l'acceptation par les citoyens de l'action de l'État, ce n'est pas terrible. Si on ne fait rien maintenant, ça ne pourra que créer des tensions entre les autorités et les citoyens.
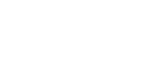
 Ryanair quitte Bordeaux « après avoir vampirisé les aides publiques »
Ryanair quitte Bordeaux « après avoir vampirisé les aides publiques »

Sujets les + commentés