
Sur le principe, il y a un large consensus. La création de zones à faibles émissions (ZFE) prévue dans le cadre de la loi Climat et Résilience votée en 2021 doit permettre une amélioration de la qualité de l'air et in fine de la santé. Selon des données de Santé publique France, entre 40.000 et 50.000 décès prématurés seraient imputables à une exposition aux particules fines. « Nous souscrivons à l'objectif santé », assure Pierre Goguet, membre du bureau du Medef Gironde et président d'honoraire de la CCI France. C'est en revanche l'application du dispositif qui pose question et a fait l'objet d'un échange dans le cadre du Forum Zéro Carbone organisé à Bordeaux. Objectif : poser les enjeux et donner de l'information. Car « il y a un réel manque de pédagogie sur les ZFE », rapporte Christian Broucaret, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports en Nouvelle-Aquitaine, qui plaide pour accompagner les ZFE par un investissement plus massif dans les transports en commun pour offrir une vraie alternative à la voiture.
En l'occurrence, si onze métropoles ont déjà instauré une zone à faibles émissions en raison d'un dépassement du seuil de pollution de l'air, à Bordeaux Métropole, la ZFE sera effective au 1er janvier 2025. « Les véhicules les plus polluants -Crit'air 4 et 5 (1)- seront alors interdits dans un périmètre intra-rocade 24/24 et 7/7 », explique Claudine Bichet, vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge du climat, de la transition énergétique et de la santé. « Cela nécessite d'étudier les impacts pour les différentes parties prenantes : entreprises, salariés, transporteurs, étudiants, commerçants », rebondit Pierre Goguet, qui témoigne des craintes du monde économique.
« Dans une décision d'installation d'entreprise, l'accessibilité représente 60 % de la décision d'un chef d'entreprise. Si nous allons jusqu'au crit'air 3, ce qui arrivera à un moment donné, près de 40 % du parc automobile de Bordeaux Métropole ne pourra plus circuler. Nous craignons un impact significatif sur le commerce, sur les artisans qui renonceraient à rentrer dans la métropole », expose-t-il.
Le premier frein ? Le coût d'un véhicule électrique et un écart qui reste conséquent malgré les aides. « Le véhicule électrique le moins cher du marché coûte 22.000 euros et une prime à la conversion s'élève au maximum à 5.000 euros », avance Etienne Chaufour, directeur en charge notamment des mobilités et des solidarités chez France Urbaine qui souligne également la problématique des délais de livraison des nouveaux véhicules.
« Les acteurs économiques n'auront pas la capacité de changer de véhicule avant 2030 parce que le cycle économique n'existe pas et que les délais de livraison sont longs, de deux ans en moyenne ! »
Des adaptations
Dans ce contexte, France Urbaine vient de rendre au gouvernement une série de propositions d'adaptations issues d'un groupe de travail qui se réunit depuis janvier 2023. Le tout sur fond d'intense lobbying parlementaire pour assouplir ou décaler la mesure. Etienne Chaufour a présenté les principales pistes. « Il est prioritairement demandé que toutes les aides concernent le territoire métropolitain et les territoires voisins qui seront impactés aussi », insiste-t-il d'emblée avant de dérouler : « Le groupe de travail demande un accompagnement acceptable sous conditions de ressources. Les aides doivent être versées rapidement pour éviter aux ménages de devoir avancer des sommes conséquentes. »
Sur la question des aides, France urbaine demande plus précisément que l'Etat double les primes à la conversion.
« Elles sont aujourd'hui insuffisantes ! Donc il n'y aura pas d'autre choix que d'abonder mais cela pose question », réagit Claudine Bichet. « Est-ce que c'est le rôle d'une collectivité de financer l'achat de véhicules alors que nous sommes attendus sur les infrastructures en matière de mobilité ? »
Pierre Goguet insiste, pour sa part, sur la question de la mesure du préjudice à prendre en compte pour les professionnels. « Une indemnisation pourrait permettre de le résorber. »
Le groupe de travail mené par France Urbaine insiste également sur la nécessité de développer les mobilités dans les territoires. Et de citer, au-delà du RER Métropolitain, des bus urbains qui circuleraient dans un périmètre de 30 à 40 kilomètres, ce qui implique des réflexions à mener avec les territoires voisins pour aller plus vite et plus fort. « Quant aux acteurs économiques qui n'auront pas la capacité de changer de véhicule avant 2030 nous demandons à ce que les véhicules lourds puissent continuer à rentrer sur le territoire jusqu'en 2030 », explique Etienne Dufour.
Des alternatives et des réserves
Si la voiture électrique est aujourd'hui dans toutes les bouches, d'autres alternatives sont malgré tout possibles. « Nous pouvons monter en puissance sur le bio-carburant sachant qu'aujourd'hui, un nouveau bus sur deux roule au bio GNV. C'est une solution pour les transports lourds mais aussi les utilitaires », assure Magali Poinsu, directrice de la RSE, de la communication et des relations extérieures chez Regaz Bordeaux. Il s'agit d'utiliser du gaz vert, possiblement produit sur place, pour alimenter les véhicules. Une solution compatible avec les exigences des ZFE.
Possible pour le bio GNV comme l'électrique, le retrofit arrive également en bonne position. « Cela fonctionne, une filière se créée. Mais il va falloir lever des freins réglementaires. Seulement six véhicules sont à ce jour homologués », regrette Claudine Bichet, de Bordeaux Métropole qui insiste sur une incongruité également relayée par Etienne Dufour de France Urbaine. Tous les deux demandent une révision des vignettes Crit'air qui intègrent la qualité de l'air mais pas l'empreinte carbone des véhicules alors que le poids des véhicules augmente considérablement avec le succès des SUV.
Les échanges sur la ZFE auraient pu se poursuivre longtemps tellement le sujet soulève des questionnements variés. « Il faudra notamment se pencher sur la question du contrôle », a simplement conclu Etienne Chaufour.
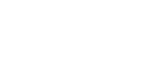
 Une ferme géante de plus de 3.000 bovins soulève l'inquiétude dans le Limousin
Une ferme géante de plus de 3.000 bovins soulève l'inquiétude dans le Limousin

Sujets les + commentés