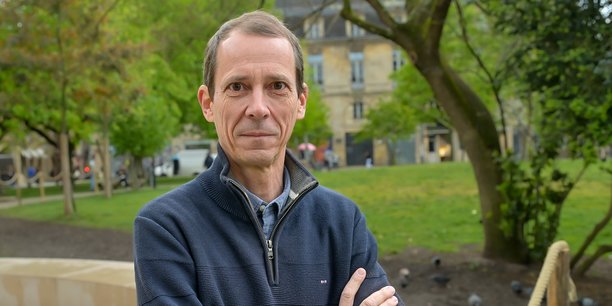
LA TRIBUNE - Quelles leçons retenez-vous du formidable essor des transports survenu depuis 50 ans ?
Laurent CASTAIGNÈDE (*) - Le principal enseignement c'est que la promesse a toujours été la même : des transports plus rapides et moins chers pour gagner du temps ! Mais, en réalité, les gens ne gagnent pas du temps, ils se déplacent plus loin ou plus souvent, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Ce sont ces mêmes arguments que l'on retrouve aujourd'hui pour promouvoir les lignes à grande vitesse ou le low-cost aérien.
La deuxième leçon c'est une forme d'aveuglement vis-à-vis de la promesse technologique : plus les problèmes générés sont importants, plus ce « messianisme technologique », déjà dénoncé par Jacques Ellul, est appuyé et prend la forme d'un nouveau sacré. La déviance derrière cela c'est de croire que ces solutions techniques seront généralisables sans questionner leur pertinence ni changer nos usages.
Pourtant, quelles que soient ces solutions techniques envisagées, vous pointez des limites bien réelles...
Oui, le point commun à toutes ces solutions c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde ! Que ce soit la voiture électrique, les agrocarburants, les carburants de synthèse ou même le mirage de l'hydrogène, il y a un problème fondamental de quantité disponible des ressources tant énergétiques que métalliques, pour les batteries, pour répondre à la totalité de la mobilité mondiale. Ces technologies devront donc nécessairement être fléchées vers certains usages en fonction de leur efficacité et de leur coût. Finalement, cela reposera la question survenue pendant la pandémie des usages essentiels et de ce qui relève des loisirs ou de l'agrément. Et cela est bien en concurrence avec d'autres usages que la mobilité.
Par exemple, l'hydrogène, même vert, a peu de chances d'être pertinent pour les transports tant les usages sont nombreux pour l'industrie. Ne parlons même pas de l'avion à hydrogène qui ne sera au mieux que pour du court-courrier et qui arrivera, de toute façon, bien trop tard pour répondre à l'urgence climatique actuelle.
Pourtant, mises bout à bout, ces solutions techniques ne peuvent-elles pas permettre de décarboner les transports ?
Non, même en combinant tous ces moyens, on sera très loin de pouvoir remplacer l'ensemble de la production pétrolière, qui atteint 100 millions de barils par jour pour, très majoritairement, finir dans les transports. D'autant que la voiture électrique est présentée comme une substitution au véhicule thermique mais, en réalité, on constate qu'elle s'ajoute au parc actuel. Dans 20 ans, il y aura globalement davantage de véhicules thermiques qu'aujourd'hui si rien ne change dans nos modes de vie. Et, même en France et en Europe, se posera la question de savoir comment on alimente en électricité ces véhicules à batteries. Il y a un problème évident de calendrier entre la croissance prévue du parc de véhicules électriques et la mise en service des futurs EPR qui n'interviendra pas avant une quinzaine d'années.
Dans ces conditions, peut-on envisager de décarboner les transports sans revoir nos usages individuels et collectifs ?
Je pense que non ! Soyons clairs : toutes ces solutions techniques ne sont absolument pas à jeter mais, seules, elles ne suffiront clairement pas. Elles ne sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes, sauf peut-être l'avion à hydrogène qui me semble inutile, mais la déviance c'est de croire qu'elles seront généralisables sans questionner leur pertinence ni nos usages.
Des transports polluants Selon Laurent Castaignède, « les transports pèsent globalement un tiers des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, c'est-à-dire en comptant la construction et l'entretien des infrastructures. Dans ce total, les voitures pèsent 40 %, les camions 30 % et les avions environ 20 %. S'agissant de la pollution de l'air, les transports représentent aussi environ un tiers en moyenne mais avec des disparités géographiques très marquées. »
Vous préconisez de flécher chaque solution vers certains usages prioritaires. Comment cela pourrait-il se concrétiser ?
Prenons le véhicule électrique : c'est une bonne solution mais qui n'est vraiment pertinente que pour des usages urbains intensifs - petites citadines, taxis, bus et logistique urbaine - et pour les deux-roues pour lutter contre la pollution de l'air. Mais on ne pourra pas généraliser les véhicules électriques donc, pour le reste du parc automobile, il vaut mieux prioriser par exemple l'hybridation légère des véhicules à essence, avec une batterie plus petite, tout en limitant le poids global des véhicules. De ce point de vue, les SUV électriques qu'on voit apparaître sont une pure aberration à la fois en termes d'usages, d'efficacité énergétique et d'allocation des ressources disponibles !
Au niveau industriel, il y a un intérêt évident à continuer à produire et à vendre comme cela. Au niveau politique, la seule boussole des décideurs c'est la croissance économique, c'est-à-dire la croissance des échanges commerciaux. Cela a trois effets : développer les infrastructures, fabriquer et vendre des véhicules et donc, in fine, éloigner les acteurs économiques les uns des autres au détriment des échanges non marchands. Derrière tout cela, il y a un mot tabou : « moins » ! Il faudrait une forme de « démobilité », c'est-à-dire moins de véhicules, moins rapides et moins lourds et pour y arriver il faut mobiliser à la fois la règlementation, la fiscalité et l'imaginaire collectif.
Quelles formes la règlementation pourrait-elle prendre ?
Sur le cas des jets privés qui sont, sauf exception, une gabegie, l'incitation ne fonctionne pas et la taxe ne sera jamais suffisamment dissuasive même en fiscalisant le kérosène. La règlementation reste donc la seule piste efficace pour en limiter l'usage. Sur ce sujet, comme sur la limitation du poids des véhicules individuels, on ne pourra pas passer à côté de contraintes règlementaires. Je propose par exemple de limiter à 1,5 tonne le poids des véhicules individuels avec des exceptions professionnelles et un bridage à 90 km/h pour les véhicules particuliers plus lourds. Sur ces deux sujets, comme sur beaucoup d'autres, si on ne touche pas à la règlementation, on n'arrivera à rien !

Laurent Castaignède (crédits : Agence APPA).
Vous préconisez aussi des règlementations en matière de transport aérien ?
Oui, il y a des pistes règlementaires à creuser avec de nouvelles spécifications techniques pour les nouveaux appareils. C'est le rôle de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) de prendre ces décisions pour imposer, par exemple, des avions à turbopropulseurs pour opérer des vols sous les 7.000 m (23.000 pieds) à une vitesse maximale de 600 km/h. En contrepartie de temps de trajet rallongés de quelques minutes à quelques heures, cela permettrait de réduire presque immédiatement la consommation de kérosène de 30 % et de supprimer complètement les traînées blanches polluantes ! Et, pourquoi pas, imaginer un quota raisonnable de vol aérien de 1.000 kilomètres par an et par personne assorti d'une très forte taxation au-delà ? Je rappelle que l'OACI est une émanation de l'ONU et devrait donc prendre en compte les contraintes des Accords de Paris. Force est de constater qu'elle ne remplit pas cette mission.
En pratique, toutes ces mesures seront immanquablement combattues par de nombreux lobbies à commencer par les industries de l'aéronautique, de l'automobile et du tourisme...
C'est vrai mais je suis convaincu que ces oppositions ne sont pas aussi nombreuses qu'on veut bien nous le faire croire et qu'elles sont surtout portées par les dirigeants des entreprises de l'aéronautique ! D'une part, les salariés de l'aérien ne réclament pas cette croissance effrénée du trafic qui s'est globalement traduite par la dégradation de leurs conditions de travail. D'autre part, la stabilisation du parc d'avions comme de celui des voitures permettrait de conserver globalement le niveau d'emplois liés à leur fonctionnement avec, c'est vrai, une diminution en Occident et une augmentation en Asie et en Afrique. En revanche, sur la construction il y aura un impact puisqu'un véhicule neuf sur deux vient en remplacer un qui part à la casse tandis que le deuxième s'ajoute. On risque donc de diviser par deux le nombre d'emplois, ce qui pose une vraie problématique. Mais le développement des activités de remotorisation et de reconditionnement pourra prendre en partie le relais.
Qu'en est-il pour les métiers touristiques alors que des destinations et pays entiers reposent sur cette activité ?
Je considère qu'il y a une fausse promesse entre l'avion et le tourisme. La baisse des prix et des durées des trajets a entraîné une segmentation du marché qui bénéficie finalement davantage au monde de l'aérien qu'aux acteurs touristiques puisque le nombre global de nuitées touristiques ne progresse pas aussi vite que le nombre de trajets. Schématiquement, les gens font plusieurs séjours courts au lieu d'un seul séjour long.
Mais je ne prétends pas qu'il n'y aura pas de bouleversements, je dis qu'il y aura à la fois des gagnants et des perdants ! Si l'avion était deux fois plus cher et un peu moins rapide, les modes de consommation et les choix des destinations évolueraient en profondeur mais je ne crois pas à un effondrement. On a vu pendant l'été 2020 et l'été 2021 que les Français ont redécouvert massivement les destinations françaises... au grand plaisir des acteurs locaux du tourisme.
Sur le plan de la fiscalité, que proposez-vous ?
C'est un outil nécessaire, ne serait-ce que pour taxer les carburants fossiles à un niveau normal alors qu'ils sont aujourd'hui beaucoup moins taxés qu'ils ne l'étaient il y a un siècle. À l'inverse, une très grosse partie des externalités négatives et des infrastructures de l'automobile sont prises en charge par la collectivité. Je pense donc qu'il faut rééquilibrer cela par une fiscalité plus forte sur les automobilistes. Plus globalement, il faut ralentir et renchérir les transports, c'est-à-dire faire en sorte de circuler moins souvent, moins vite et avec moins de véhicules. Cela passera donc au moins en partie par des taxes. C'est valable à la fois pour la mobilité contrainte, chère et pas sympa, et pour la mobilité choisie de loisirs qui est exagérée.
Ces mesures se traduiraient donc par un carburant plus cher pour alimenter un véhicule plus léger et plus lent. Cinq ans après les Gilets Jaunes cela pose d'évidentes questions d'acceptabilité sociale...
Oui mais, au fond, cela pose surtout une question fondamentale : est-ce que le carburant fossile doit être considéré comme un produit de première nécessité ou comme le tabac ? À mon sens, le carburant doit être traité comme le tabac, c'est-à-dire un produit nocif qui entraîne une addiction et dont il faut diminuer la consommation. Cela implique donc de traiter le problème en accompagnant les personnes souffrant d'addictions et en mettant d'importants moyens pour leur proposer des alternatives et diminuer leur consommation. Cela signifie qu'on fixe collectivement une trajectoire de sortie du fossile, qu'on accepte de le taxer lourdement pour aller vers un litre de carburant compris en 3 et 5 euros, qu'on en interdit la publicité, qu'on construit des substituts solides et qu'on ne propose surtout pas de chèques carburants qui reviennent à offrir des cigarettes gratuites à des fumeurs !
L'acceptabilité sociale est un vrai sujet qui correspond en réalité à une multitude de cas par cas à qui la collectivité doit proposer des solutions : construire des transports en commun efficaces ; déconcentrer les services publics et les entreprises privées vers les villes moyennes et les périphéries ; multiplier les tiers-lieux ; prévoir des aides au déménagement ou au changement de véhicules, etc. Et pour cela il faut aussi changer les imaginaires véhiculés par les grands évènements internationaux et les grands sportifs.
(*) L'essayiste bordelais et ingénieur centralien Laurent Castaignède est consultant en bilan carbone après avoir mené une carrière dans l'automobile chez Renault. Il a récemment publié « Airvore ou le mythe des transports propres : Chronique d'une pollution annoncée » (2022, Écosociété, 423 pages, 25 €) et « La bougeotte, nouveau mal du siècle ? » (2021, Écosociété, 166 pages, 15 €).
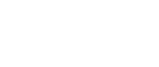
 Etranglé par la concurrence de Tarbes, l'aéroport de Pau-Pyrénées est-il condamné ?
Etranglé par la concurrence de Tarbes, l'aéroport de Pau-Pyrénées est-il condamné ?

Sujets les + commentés